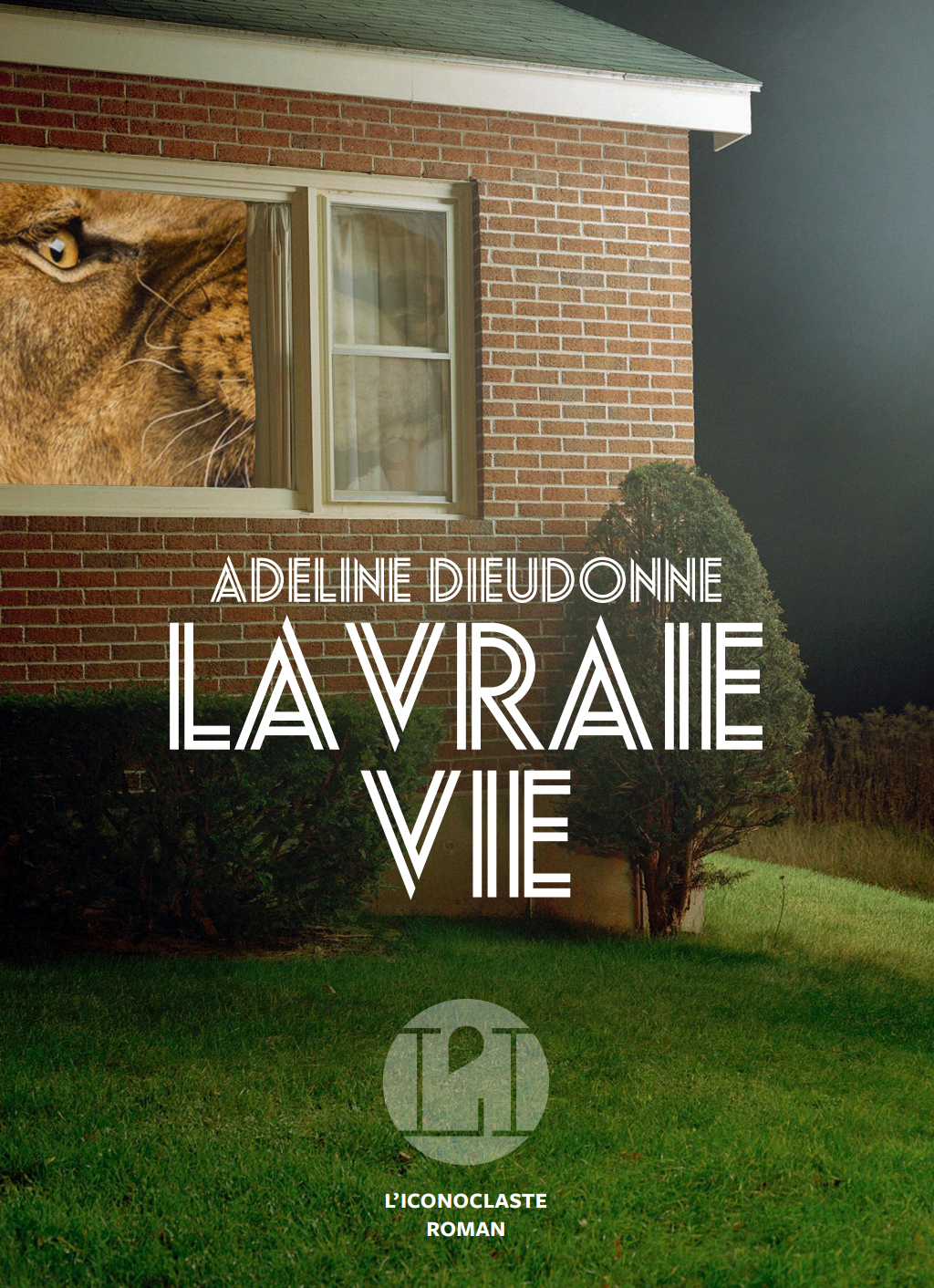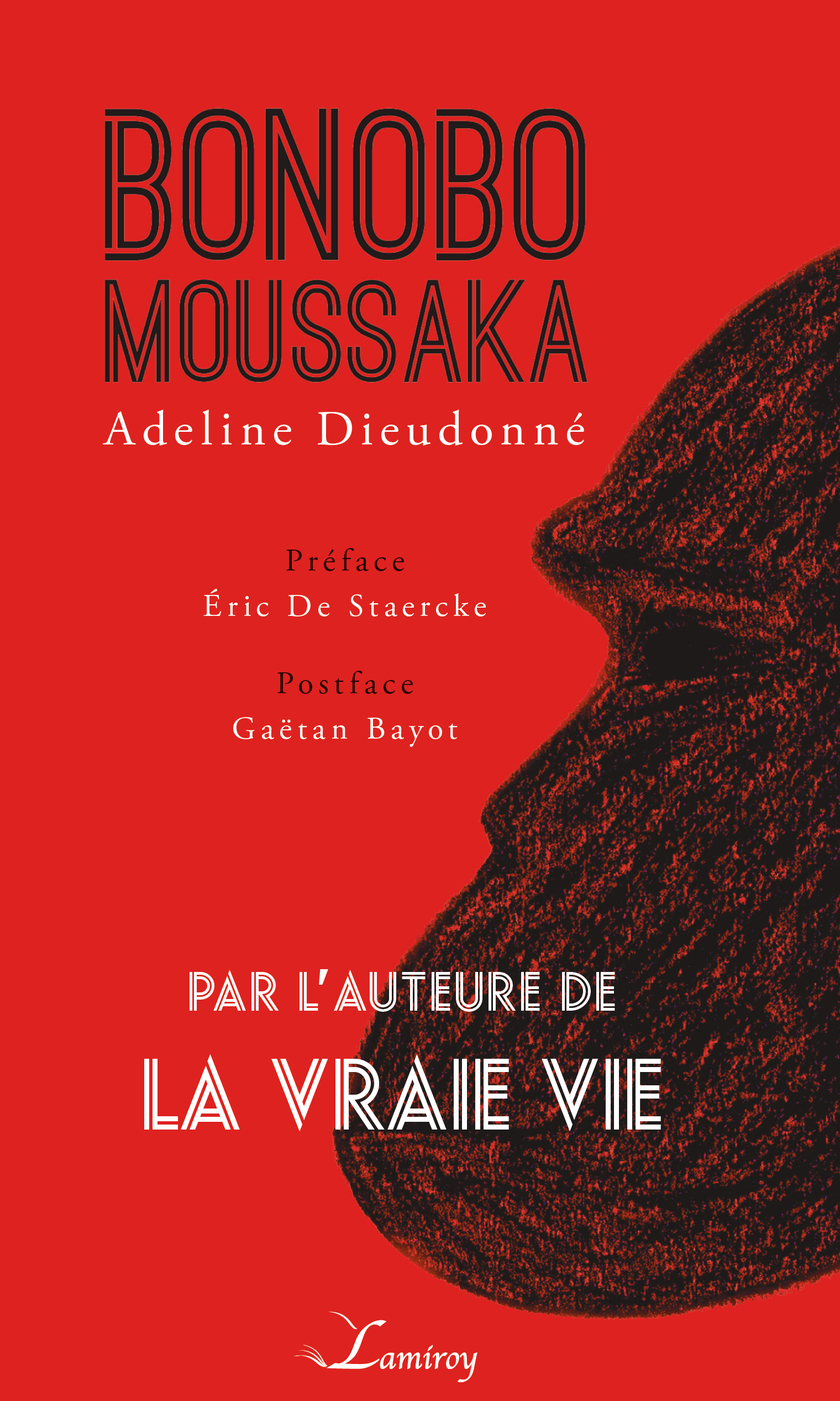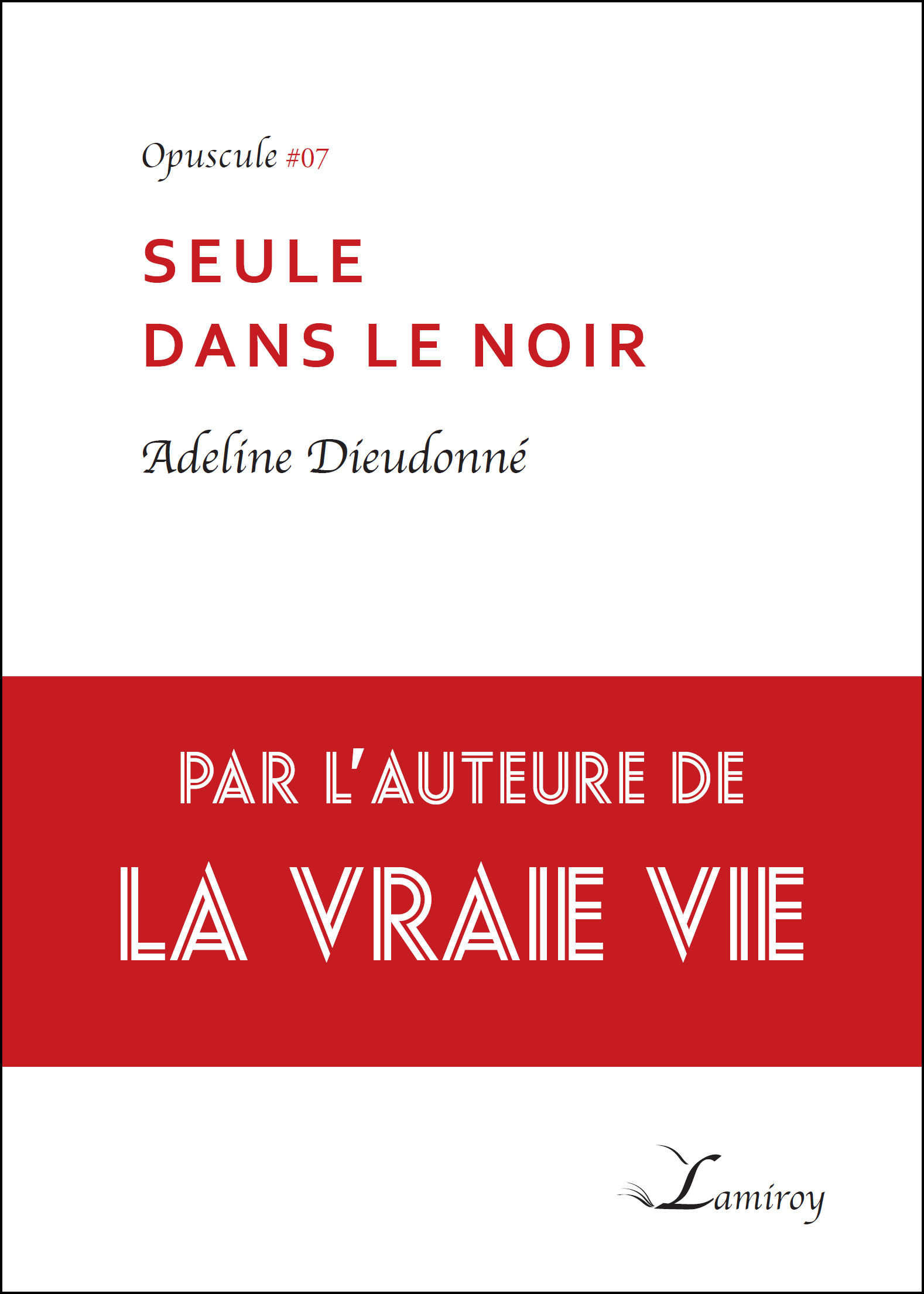Ça commence comme une blague, une méchante blague à la Stephen King. Notre héroïne, jeune anonyme au je, partage sa vie entre son amour de petit frère, son tyran de père et son amibe de mère. L’enfance encore, nimbée de peurs déjà, de violences et parfois du doux réconfort de l’heure de La Valse des fleurs, le carillon du marchand de glaces. Gourmandise, péché capital, une pointe de chantilly interdite sur sa chocolat-stracciatella, le siphon explose, la tête du marchand de glaces explose, l’enfance explose, le petit frère implose. Trois longs jours il gardera le silence, seul le regard de la hyène, celle que l’on a entendu ricaner quand le silence se coulait en sang, celle de la chambre aux cadavres du père chasseur, celle qui se planquait sous nos lits de mômes, lui redonnera un semblant de vie. Et puis, mystérieusement, les chats du quartier se mettent à disparaître…
Un soir d’été, ma mère avait fait des pêches au thon que nous avions mangées sur la terrasse en pierre bleue qui donnait sur le jardin. Mon père avait déjà déserté pour s’installer devant sa télé, avec sa bouteille de Glenfiddich. Il n’aimait pas passer du temps avec nous. Je crois que, dans cette famille, personne n’aimait le moment où on se retrouvait réunis autour du repas du soir. Mais mon père nous imposait ce rituel, autant qu’il se l’imposait à lui-même. Parce que c’était comme ça. Une famille, ça prend ses repas ensemble, plaisir ou pas. C’était ce qu’on voyait à la télé. Sauf qu’à la télé, ils avaient l’air heureux. Surtout dans les pubs. Ça discutait, ça riait. Les gens étaient beaux et ils s’aimaient. Le temps passé en famille nous était vendu comme une récompense. Avec le Ferrero Rocher, c’était supposé être la friandise à laquelle on a droit après les heures passées à travailler au bureau ou à l’école. Chez nous, les repas familiaux ressemblaient à une punition, un grand verre de pisse qu’on devait boire quotidiennement. Chaque soirée se déroulait selon un rituel qui confinait au sacré. Mon père regardait le journal télévisé, en expliquant chaque sujet à ma mère, partant du principe qu’elle n’était pas capable de comprendre la moindre information sans son éclairage. C’était important le journal télévisé pour mon père. Commenter l’actualité lui donnait l’impression d’avoir un rôle à y jouer. Comme si le monde attendait ses réflexions pour évoluer dans le bon sens. Quand le générique de fin retentissait, ma mère criait : « À table ! »
Pour l’ambiance, vous l’aurez compris, nous nous situons entre un très bon roman fin d’enfance du King et une Alice passée de l’autre côté du miroir. Les adultes – le père surtout – enlèvent leur masque et derrière ne se cache pas un clown, mais bien un Ça. Les balades, en famille, en forêt, tournent au plus pur cauchemar, nous aurions craint de l’imaginer que nous serions encore passés à côté. Le petit frère si adorable des premiers temps, malgré son tout jeune âge, devient carrément inquiétant et la mère, la mère l’amibe, reste figée, incapable d’échapper à la violence dont elle est la première victime. C’est d’ailleurs ce qui est remarquable, tragique et sidérant, dans ce premier roman de la jeune Belge Adeline Dieudonné, toutes les femmes sont victimes, et dans le même temps c’est le récit de la fin d’enfance d’une gamine forte et volontaire, perdue entre ses désirs et ses rêves, percluse de douleurs et de drames, qui va tendre sa volonté comme un arc et subir, supporter, renverser, accepter, accepter tout, même l’inimaginable. Un pur roman féministe d’une pure héroïne d’à peine quinze ans qui nous transporte dans sa quête effrénée de rétablir un minimum d’amour et de sagesse dans son monde qui devient fou, complètement fou. Une herbe sauvage, une herbe folle, qui bon an, mal an, dans la tourmente qui l’agite et qui agite les siens continue de pousser droit, fière et belle. Quand le retour en arrière est impossible, quand la transmission est impossible, de quoi se nourrit-on ?
À la maison, j’avais fabriqué de nouvelles marionnettes, inventé de nouvelles histoires. Il s’asseyait devant moi, mon tout petit spectateur. Je lui parlais de princesses qui se prennent les pieds dans leur robe, de princes charmants qui font des prouts, de dragons qui ont le hoquet… Finalement, sans trop savoir pourquoi, je l’ai emmené dans la chambre des cadavres. Mon père était au travail et ma mère s’était absentée pour faire des courses. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre, j’ai senti le regard de la hyène dans mon dos. Mes yeux ont soigneusement évité de rencontrer les siens.
C’est à ce moment-là que j’ai compris. Ça a fondu sur moi comme un fauve affamé, lacérant mon dos de ses pattes griffues. Le rire que j’avais entendu quand le visage du vieux avait explosé, il venait d’elle. La chose que je ne pouvais pas nommer, mais qui planait, cette chose vivait à l’intérieur de la hyène. Ce corps empaillé était l’antre d’un monstre. La mort habitait chez nous. Et elle me scrutait de ses yeux de verre. Son regard mordait ma nuque, se délectait de l’odeur sucrée de mon petit frère.
En quoi ce roman est-il uppercut ? Il vous faudra patienter quelques semaines pour découvrir l’intrigue de ce petit miracle qui empêche qu’une seule seconde on le repose. Son auteure vient du théâtre, est-ce grâce à cela qu’elle a su tisser sa trame avec adresse, sans temps morts, sans fausses notes ? D’une écriture qui ne se veut pas littéraire mais foncièrement vivante, elle a su créer un personnage vieillie trop vite, oscillant entre la candeur de l’enfance, avec cette naïveté qui sait se montrer drôle, et la violence d’un passage à l’âge adulte qui ressemble plus à un rite initiatique qu’à la cocasserie de nos adolescences chips, coca et grands drames existentiels. Dans La Vraie vie notre anonyme n’a pas le temps de voir passer ces six étés, six étés à se planquer, à tenter malgré tout de devenir soi, six étés jusqu’à une soirée de trop, paroxysme qui vous transcendera, qui la transcendera, autant qu’il vous mettra les larmes aux yeux (et la rage à la gorge). C’est très, très réussi, ça sort le 29 août, et vous en entendrez vite (et longtemps) parler, patience !
Amandine Glévarec / Kroniques.com